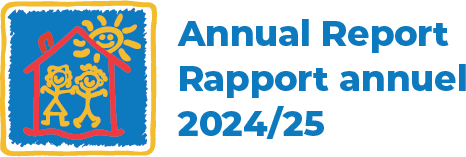Services de protection fournis par la Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa :
Selon les données sur les services pour 2024-2025.
Données sur les services : Examen approfondi
Accueil et évaluation
Les membres de la collectivité qui soupçonnent un parent ou une fournisseuse de soins d’avoir posé ou omis de poser des gestes qui ont causé ou pourraient causer un préjudice à une enfant ou à une jeune sont encouragés à faire un signalement à la Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa à toute heure du jour ou de la nuit, sept jours par semaine. Les signalements peuvent être faits par téléphone, par écrit, par courriel, en personne ou à la police.
Une équipe d’intervenantes en évaluation examine tous les signalements reçus à l’aide d’un outil normalisé, appelé Échelles d’admissibilité des services de bien-être de l’enfance de l’Ontario, pour déterminer si les préoccupations soulevées correspondent aux critères d’admissibilité aux services de protection de l’enfance. Cet outil favorise la prise de décisions cohérentes, équitables et fondées sur les normes provinciales. Cliquez sur le lien suivant pour accéder à l’outil : Échelles d’admissibilité de 2024 des services de bien-être de l’enfance de l’Ontario.
Continuer à lire
En dehors des heures d’ouverture, y compris les soirs, les fins de semaine et les jours fériés, une équipe de la SAEO, qui est composée d’intervenantes et de superviseures en services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille chevronnées, est disponible pour répondre aux signalements concernant les cas de négligence et de maltraitance des enfants.
Une intervenante en évaluation entre en jeu immédiatement si l’information fournie indique qu’une enfant ou une jeune est exposée à un danger imminent ou s’il y a des signes de blessure suspecte. Si le signalement répond aux critères d’admissibilité aux services mais ne constitue pas une urgence, le délai de réponse par la SAEO est de sept jours.
Dès que la SAEO est appelée auprès d’une famille, le rôle de l’intervenante est d’évaluer la situation et de déterminer s’il y a un risque de maltraitance chez l’enfant qui nécessiterait une intervention. Dans de nombreux cas, une intervention de courte durée à l’étape de l’évaluation est suffisante pour aider les familles à améliorer leur capacité à prendre soin de leurs enfants de façon sécuritaire.
Au cours du dernier exercice, la SAEO a connu une augmentation de près de 3 % du nombre de dossiers à évaluer par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse peut être en partie attribuable à la reprise des activités après la pandémie, augmentant la visibilité des enfants et des jeunes au sein de la collectivité. De plus, la pandémie a eu des effets durables sur les enfants, les jeunes et les familles, notamment des problèmes de santé mentale de plus en plus complexes, qui peuvent également contribuer à la hausse du nombre de signalements.
Lire moins
Services continus
Lorsque les préoccupations concernant la sécurité de l’enfant ne sont pas résolues à l’étape de l’évaluation initiale, la famille est mise en contact avec une intervenante en services continus. Celle-ci a la responsabilité de veiller à ce que le plan de service établi lors de l’évaluation soit mis en œuvre, et à ce que la famille reçoive du soutien pour atteindre ses objectifs dans le cadre d’un engagement constant.
Les familles participent activement au processus d’évaluation continue. Elles apprennent notamment à établir un réseau de sécurité, ainsi qu’à cerner les signes de sécurité, les risques, les facteurs aggravants, les forces et les ressources disponibles. L’intervenante continue d’évaluer les facteurs de protection et les facteurs de risque, tout en collaborant avec la famille et son réseau de soutien pour élaborer un plan de sécurité visant à atténuer les risques cernés.
Continuer à lire
Entre les exercices 2019-2020 et 2022-2023, il y a eu une baisse du nombre de dossiers de services continus de protection de l’enfance gérés par la SAEO. Cette tendance est similaire à celle observée pour les évaluations initiales, comme l’indique la figure 1, et est probablement le reflet de l’impact général et continu de la pandémie de COVID-19 sur les enfants, les jeunes et les familles. Bien que le nombre d’évaluations en protection de l’enfance ait augmenté en 2024-2025, le nombre de dossiers transférés aux services continus a baissé de 27,4 %.
Pour mieux comprendre ce changement, la SAEO a entrepris un examen clinique détaillé de la façon dont les décisions sont prises en ce qui a trait aux transferts de dossiers des services d’évaluation aux services continus. Cet examen aidera à faire en sorte que les décisions continuent d’être en phase avec les pratiques exemplaires et les besoins changeants des familles de notre collectivité.
Lire moins
Enfants et jeunes prises en charge
Le nombre d’enfants et de jeunes confiées aux soins de la Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa a récemment augmenté, à la suite d’une période où le nombre de prises en charge était moins élevé, au plus fort de la pandémie de COVID-19. Nous avons connu une hausse de 4,6 % en 2024-2025 à ce chapitre par rapport au dernier exercice. Alors que les volumes de service globaux reviennent aux niveaux prépandémiques, cette hausse reflète une tendance générale de rétablissement des liens avec les systèmes communautaires, y compris les écoles, le secteur de la santé et des services sociaux, qui sont des milieux où sont souvent soulevées des préoccupations liées à la protection de l’enfance.
Continuer à lire
Bien qu’avec du soutien, la plupart des familles servies par la SAEO demeurent ensemble en toute sécurité, certaines circonstances font en sorte que la sécurité d’une enfant ne puisse pas être assurée dans son milieu de vie. Lorsque cela survient, et seulement lorsque c’est nécessaire, la SAEO organise un placement temporaire ou à long terme pour garantir le bien-être de l’enfant. Les décisions en matière de placement priorisent les options les moins perturbatrices, et mettent fortement l’accent sur les placements chez un proche, les soins conformes aux traditions (pour les enfants des Premières Nations), et les placements en milieu familial.
L’augmentation du nombre moyen d’enfants prises en charge fait l’objet d’une surveillance étroite. La SAEO demeure engagée envers la planification de la permanence, la réunification des familles lorsque c’est possible et les options de placements adaptés à la culture, de façon à favoriser la sécurité, la stabilité et le bien-être à long terme des enfants.
Lire moins
Identité culturelle des enfants et des jeunes prises en charge hors de leur foyer familial
La SAEO cherche à déterminer l’identité ethnoculturelle, sociale et linguistique de toutes les personnes qui reçoit ses services. Ces renseignements nous aident à mieux répondre aux besoins des enfants, des jeunes et des familles, en plus d’appuyer nos efforts pour évaluer et contrer la disproportion et la surreprésentation des groupes racisés parmi sa clientèle.
Nous collaborons activement avec des partenaires communautaires qui servent des populations ayant différentes identités ethnoculturelles et sociales pour veiller à ce que les services que nous fournissons soient judicieux, réactifs et adaptés aux besoins uniques de chaque famille.
La figure 4 présente les données sur l’origine ethnique des enfants et des jeunes prises en charge hors de leur foyer familial au cours des quatre derniers exercices, par rapport à l’ensemble de la population d’Ottawa (recensement de 2021). Ces données incluent les enfants et les jeunes prises en charge, placées chez des proches ou recevant des soins conformes aux traditions ainsi que les jeunes qui reçoivent des services du programme À vos marques, prêts, partez1.
Il convient de noter la surreprésentation persistante des enfants et des jeunes d’origine africaine et caribéenne, et des enfants issues des communautés inuites, métisses et des Premières Nations, dans les placements hors du foyer familial. La SAEO mène plusieurs initiatives visant à améliorer les services fournis aux enfants et aux familles de ces communautés, dont la mise en œuvre de modèles de services adaptés à la culture pour les familles de race noire et autochtones. Ces efforts sont notamment axés sur l’établissement de partenariats plus solides avec des organismes communautaires et l’amélioration de notre compréhension des défis et des obstacles systémiques particuliers auxquels font face ces familles.
La figure 5 présente une ventilation plus détaillée des données. Les enfants et les jeunes d’origine africaine et caribéenne représentent 17,2 % du total des personnes placées hors du foyer familial. Toutefois, elles représentent 29,6 % des jeunes prises en charge, un pourcentage qui inclut celles placées en milieu familial ou chez un proche2.
La plus vaste proportion d’enfants et de jeunes placées hors du foyer familial, soit 44,6 %, reçoivent des services dans le cadre du programme À vos marques, prêts, partez. Ce pourcentage témoigne de l’impact du lancement de ce programme, qui a eu lieu le 1er avril 2023, et qui repoussait à 23 ans l’âge maximal de l’admissibilité aux services. Le programme précédent, appelé Programme de soins et de soutien continus pour les jeunes, offrait des services seulement jusqu’à l’âge de 21 ans.
En outre, 20,8 % des enfants et des jeunes placées hors de leur foyer familial sont placées chez un proche. Elles vivent donc avec des membres de leur parenté ou d’autres adultes qu’elles connaissent. Bien qu’ils soient considérés comme des placements hors du foyer familial, les placements chez un proche préservent les importants liens familiaux et communautaires
Les données sur les enfants et les jeunes autochtones placées hors de leur foyer familial sont présentées selon le type de placement. Un total de 40,6 % d’entre elles sont prises en charge, ce qui en fait le plus vaste groupe. Elles sont suivies par les enfants placées chez un proche (29,1 %), et par les jeunes qui reçoivent les services du programme À vos marques, prêts, partez (20 %). Alors que seulement 1,8 % des jeunes font l’objet d’ententes formelles de soins conformes aux traditions3, il est important de prendre note qu’il existe des obstacles à l’établissement de telles ententes. Par exemple, chez 50 % des enfants et des jeunes des Premières Nations placées hors de leur foyer familial, la communauté n’est pas identifiée, ce qui les rend inadmissibles à une entente de soins conformes aux traditions.
Services de ressources
À la SAEO, les travailleuses spécialisées se concentrent sur la prestation de services dans des domaines clés, notamment la recherche et la mobilisation de familles, les placements en familles d’accueil, les placements chez un proche et les adoptions.
In 2020, la SAEO a lancé une initiative stratégique visant à réduire le recours aux foyers de groupe, laquelle progresse graduellement. Durant l’exercice 2024-2025, le recours global aux foyers de groupe a diminué légèrement pour s’établir à 12 %, par rapport à 13 % au cours de l’exercice précédent. Parallèlement, le recours à des familles d’accueil de la Société a augmenté, passant de 19 % à 22 %. Le recours aux placements en famille d’accueil dans des ressources externes rémunérées a diminué de 1 %.
Ces changements témoignent de nos progrès constants vers l’atteinte de notre objectif de réduire les placements dans des foyers de groupe et d’accroître les possibilités de placements en milieu familial. En particulier, nous observons une baisse continue du recours aux ressources rémunérées et une propension accrue à placer les enfants et les jeunes dans des milieux offrant davantage de stabilité et de possibilités de tisser des liens.
En outre, durant l’exercice, 55% des jeunes placés hors de leur milieu familial ont participé au programme À vos marques, prêts, partez. Lancé le 1er avril 2023, le programme prolonge le soutien aux jeunes jusqu’à l’âge de 23 ans, ce qui améliore notre capacité à fournir des services de transition judicieux aux jeunes plus âgées.
Placement chez un proche
L’objectif des placements chez un proche est d’offrir des soins et du soutien conformes aux traditions familiales et communautaires aux enfants qui ne peuvent pas rester avec leur famille d’origine pour des raisons de sécurité. Les familles qui fournissent ce type de services doivent faire l’objet d’un processus d’évaluation afin de mesurer leur capacité à répondre aux besoins de l’enfant ou de la jeune en matière de sécurité et de bien-être. Bien qu’ils ne soient pas tenus d’avoir une relation biologique avec l’enfant ou la jeune, les proches offrant ce type de services entretiennent souvent déjà un lien important avec elle. Il peut s’agir des grands-parents, de membres de la famille élargie, d’amies de la famille, d’entraîneuses ou d’enseignantes.
On considère qu’il est préférable de recourir aux placements chez un proche plutôt qu’à des placements en famille d’accueil ou en foyer de groupe, lorsque cela est sécuritaire. Bien que l’on constate une légère baisse dans les données ponctuelles du dernier exercice, le recours global aux placements chez un proche a augmenté de plus de 25 % depuis 2019-2020. Cette hausse constitue un indicateur positif, en particulier dans le contexte de la diminution du nombre d’enfants prises en charge au cours de la même période. Elle semble indiquer que la SAEO recherche et priorise constamment les placements chez un proche comme option moins intrusive et plus rapprochée de la famille lorsque des enfants ou des jeunes ne peuvent pas demeurer dans leur foyer familial.
Permanence
Depuis 2006, la SAEO mise sur l’augmentation de la permanence pour les enfants et les jeunes. Pour ce faire, il a fallu modifier considérablement les croyances et les pratiques en mettant l’accent sur la planification concertée, dès l’étape initiale d’évaluation. Ce virage exige d’accorder autant d’attention aux besoins de sécurité immédiats de l’enfant ou de la jeune qu’aux dispositions à plus long terme. Toutes les personnes qui participent au processus de planification doivent :
- croire que les familles peuvent acquérir et maintenir la capacité de prendre soin de leurs enfants si elles disposent des soutiens appropriés;
- agir rapidement lorsqu’une enfant ou une jeune a besoin d’être placée hors du foyer familial, et solliciter la collaboration de fournisseuses de soins provisoires auprès de la famille et la collectivité (proches);
- chercher des proches qui peuvent s’engager à offrir une permanence en adoptant ou en obtenant la garde légale de l’enfant ou de la jeune dès les premières étapes de planification et poursuivre la recherche de façon continue tant que l’enfant ou la jeune est prise en charge si elle ne peut pas retourner dans son foyer;
- réaliser que l’âge ou les besoins particuliers d’une enfant ou d’une jeune ne devraient pas être un obstacle à la permanence;
- utiliser des outils comme les génogrammes et des schémas familiaux auprès des enfants, des jeunes et des familles pour mettre sur pied des réseaux de soutien qui :
- les appuieront durant les périodes de crise afin d’assurer la sécurité de l’enfant pendant qu’elle reste à la maison;
- aideront l’enfant à se sentir liée à une identité fortement ancrée dans sa propre histoire;
- offriront un soutien pratique à l’enfant, comme le tutorat et le mentorat;
- fourniront des soins provisoires ou permanents à l’enfant ou à la jeune;
- feront preuve de créativité pour obtenir des subventions et des ressources communautaires afin de répondre aux besoins particuliers de l’enfant ou de la jeune, éliminant ainsi les obstacles à la permanence.
Pour assurer la permanence des enfants et des jeunes, la SAEO continue de faire appel à des ordonnances d’adoption et de garde légale. La figure 9 illustre les options de permanence obtenues par type de placement : adoptions, garde légale accordée en vertu de l’article 102 de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF) (une ordonnance où l’enfant ou la jeune n’a pas été confiée à une société de façon prolongée) et garde légale accordée en vertu de l’article 116 de la LSEJF (l’enfant a été confiée à une société de façon prolongée). Comme le placement provisoire d’enfants et de jeunes chez des proches mène parfois à une solution permanente dans cette famille, le travail d’évaluation et de soutien des proches est très semblable à celui de l’adoption. Cette année, par rapport à l’exercice précédent, le nombre d’adoptions finalisées a baissé de 22 %, tandis que le nombre d’ordonnances de garde légale a grimpé de 54 %.
- Le Programme de soins et de soutien continus pour les jeunes (SSCJ) était un service de soutien offert aux jeunes auparavant prises en charge qui pouvaient bénéficier d’une aide après leur 18 ᵉ anniversaire afin de faciliter leur transition vers l’autonomie. Il a été remplacé le 1ᵉʳ avril 2023 par le programme À vos marques, prêts, partez. ↩︎
- En Ontario, on parle de prise en charge chez un proche lorsqu’une enfant est placée chez une personne qu’elle connaît, comme un membre de la parenté ou une amie proche de la famille, et est officiellement considérée comme prise en charge par une société d’aide à l’enfance (SAE). Par ailleurs, le placement chez un proche est un arrangement plus informel où une enfant vit avec un adulte de confiance qu’elle connaît mais n’est pas formellement prise en charge par une SAE. Bien que ces deux approches préservent les importants liens familiaux et communautaires, seules les prises en charge chez un proche impliquent une tutelle légale en vertu du système de bien-être de l’enfance. Prise en charge chez un proche et placement chez un proche (en anglais seulement). ↩︎
- En vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF), les soins conformes aux traditions sont définis comme suit : « les soins fournis à un enfant inuit, métis ou de Premières Nations et la surveillance d’un tel enfant, par une personne qui n’est pas un parent de l’enfant, conformément à la coutume de la bande ou de la communauté inuite, métisse ou de Premières Nations à laquelle l’enfant appartient. » Au-delà de la définition juridique, les communautés inuites, métisses et de Premières Nations décrivent les soins conformes aux traditions comme une approche traditionnelle adaptée à la culture visant à soutenir les enfants et les familles. Ces soins reflètent la responsabilité du bien-être d’autrui que se partagent tous les membres de la communauté. Les soins conformes aux traditions mettent l’accent sur la prévention, la continuité culturelle et le soutien communautaire, ce qui permet aux familles de demeurer unies et de vivre d’une manière qui respecte leurs valeurs et leurs traditions.
Entente formelle de soins conformes aux traditions ↩︎